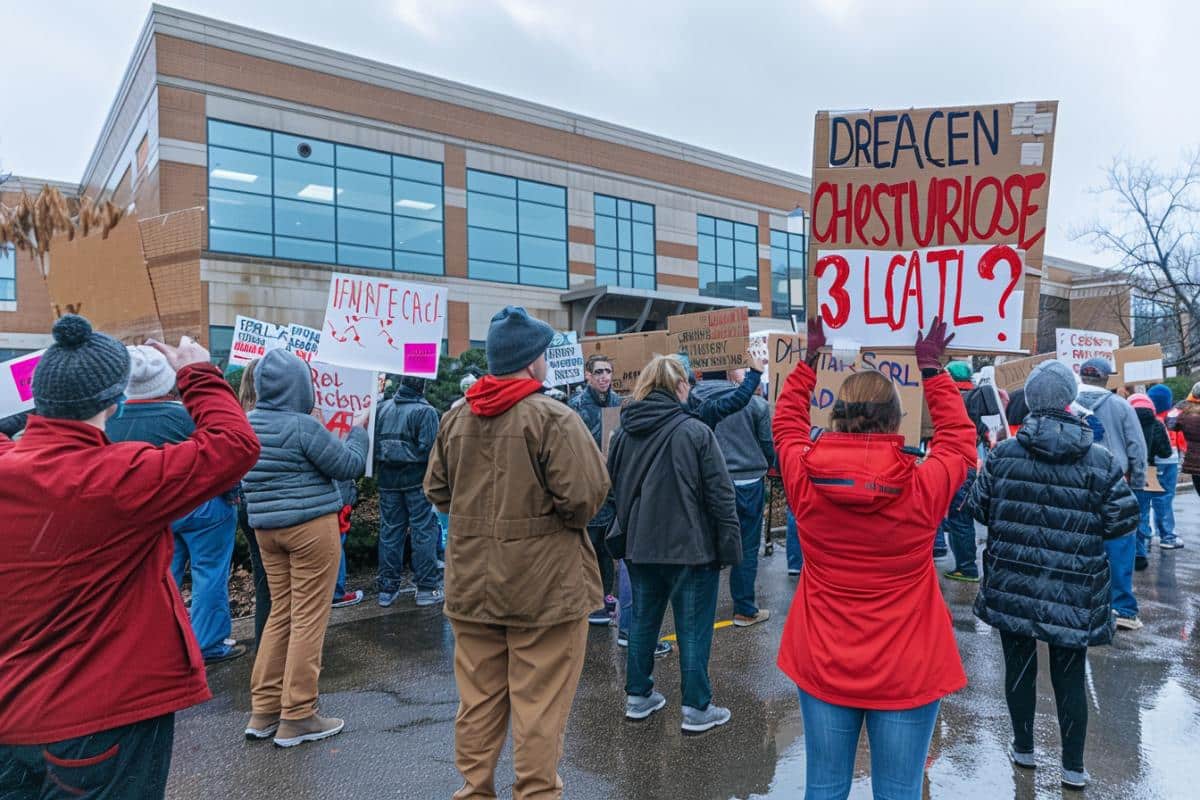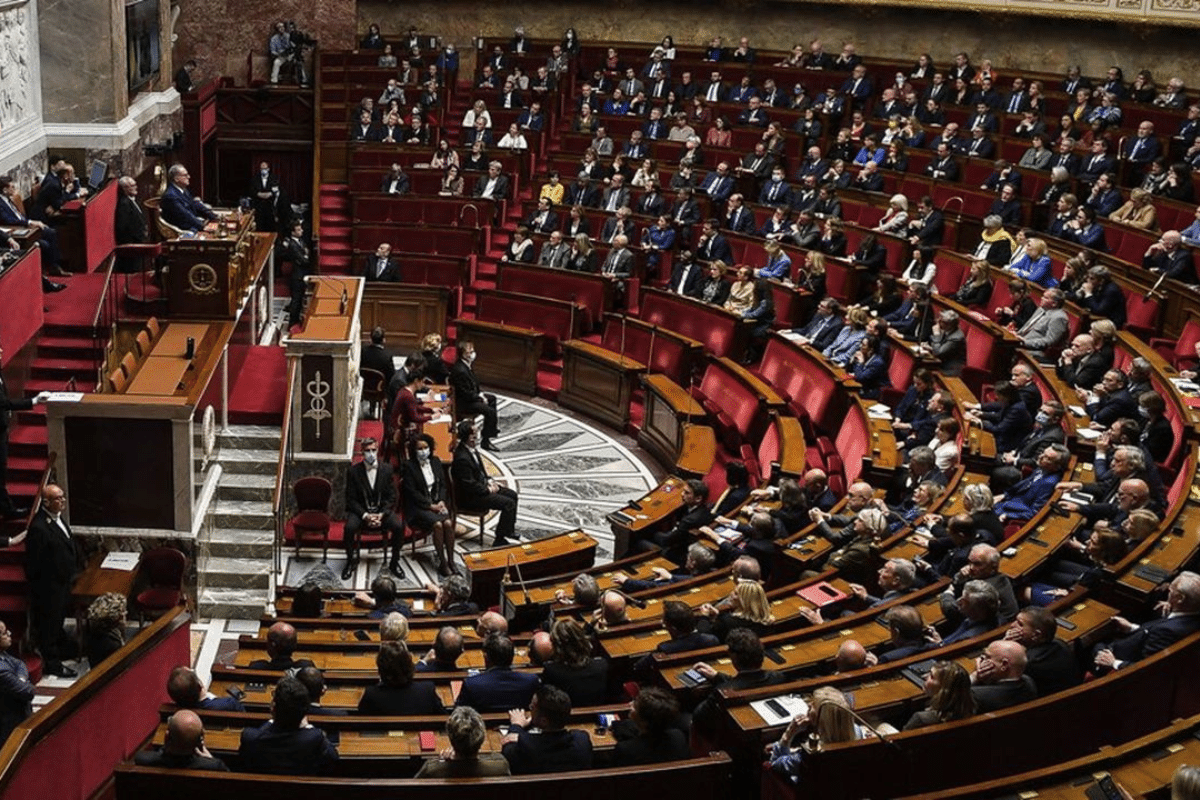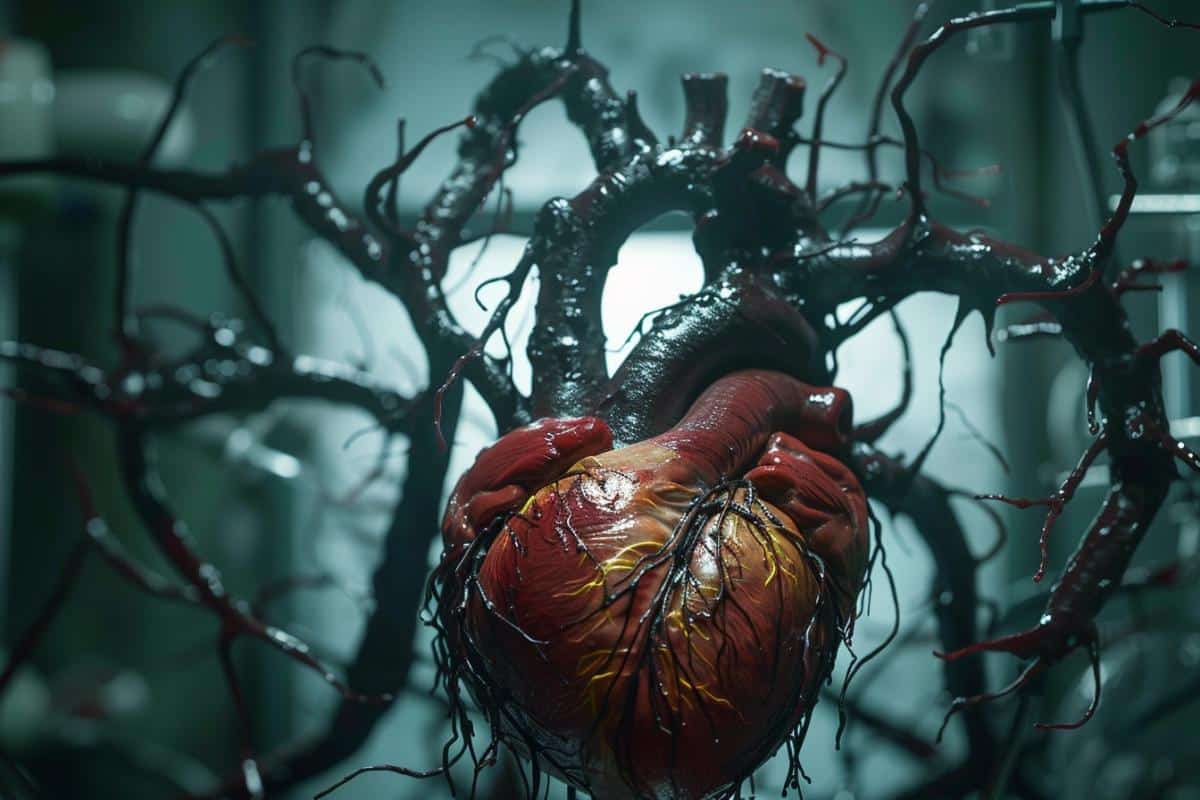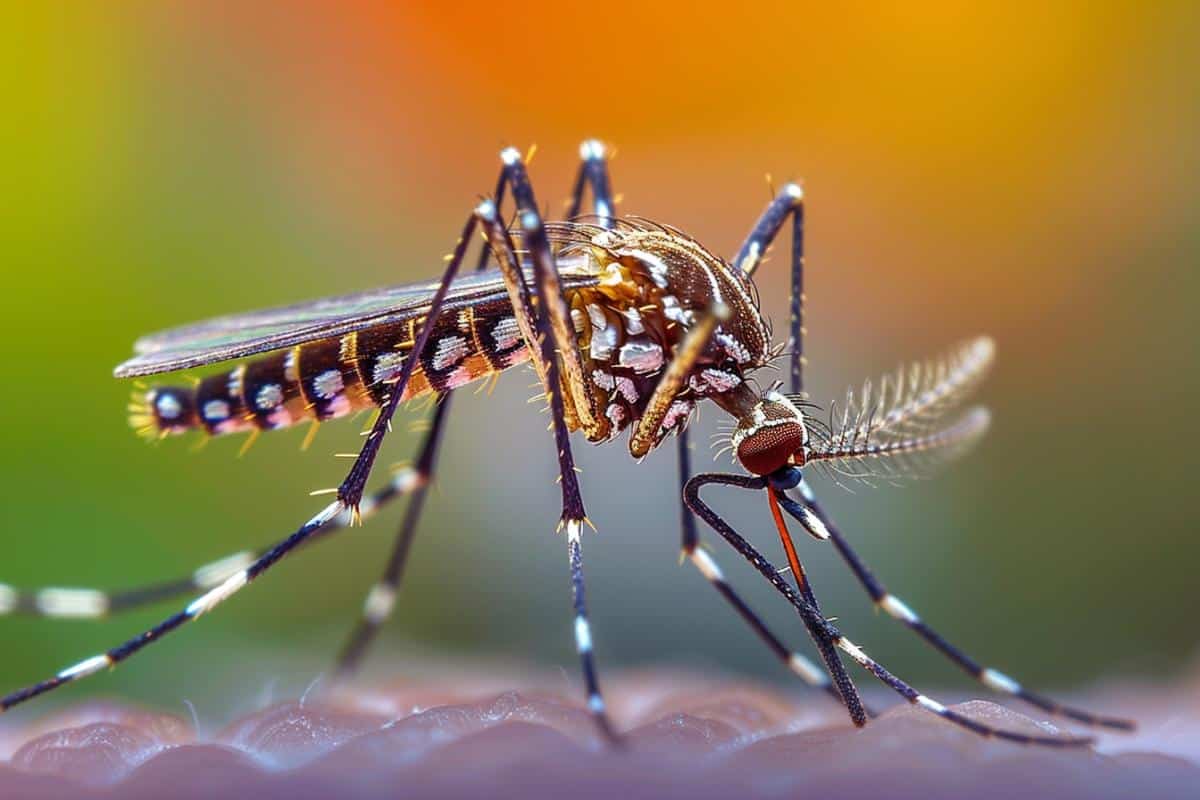Alternatives Paloises est un magazine diversifié qui explore la culture 🎭, l’économie 💼, la société, et l’environnement 🌱 de la région de Pau. Ce magazine propose des articles courts mais riches, analysant les événements locaux, les entreprises, les enjeux sociaux, et les initiatives écologiques. Avec une approche informative, Alternatives Paloises vise à offrir une vision complète de la vie paloise, en soulignant l’interaction des habitants avec leur région et leur contribution au dynamisme local.